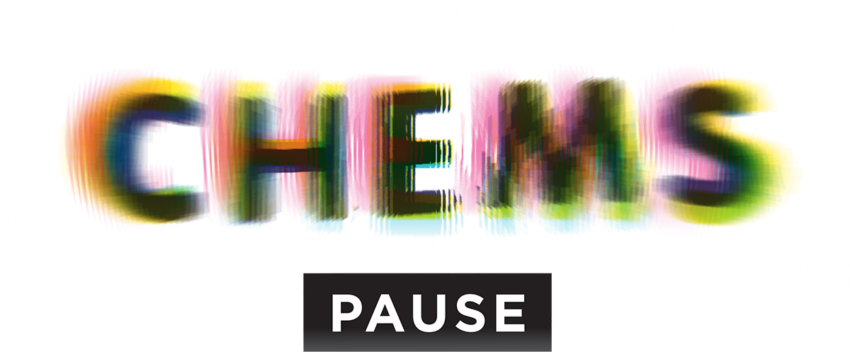|
NEWS :
194 pages en accès
Valable tout 2025. |
|
Cyrillo
 site gay gratuit |
CONCOURS D'HISTOIRES |
L’obsessionL’obsession. Troisième jour. Nous avons enfin trouvé une rivière, il s’y baigne en tentant tant bien que mal de se débarrasser des traces de suie sur sa peau. J’essaie de ne pas trop le regarder. Détourner le regard. Penser à autre chose. Troisième jour seulement après l’Événement, troisième jour seulement que cette moiteur noire obscurcit le ciel, troisième jour seulement qu’il n’y a plus que lui et moi sur Terre. Je devrais paniquer. Je devrais courir. Je devrais réfléchir à une solution, chercher d’autres survivants, peser les différentes options, mettre en place un plan de survie. Mais non. Troisième jour déjà que je ne pense qu’à son corps, à sa peau, à ses lèvres, à sa bouche, à ses cuisses, à sa gorge, à son cul. Je secoue la tête. Comme un chien, je m’ébroue. Il sort de l’eau. Me regarde. - C’est bon, j’ai fini. Je vais chercher quelque chose pour me sécher. Il ne répond pas et s’éloigne. J’enlève rapidement mon t-shirt, mon short, mon caleçon et me précipite dans l’eau fraiche. Je ne veux pas qu’il voie que je bande. L’effet du froid me permet de redescendre un peu sur terre. De me concentrer sur le réel. Les infrastructures détruites. La chaleur qui nous accable. Les plantes qui meurent autour de nous. Les corps calcinés qu’on rencontre au hasard des routes. La peur, constante, incontournable. L’inconnu. Et lui, par hasard, avec moi, nous seuls survivants ; lui qui vient de se baigner nu dans cette même rivière, qui passait ses mains sur son cou délicat, sur ses mollets imberbes…. Putain ! Il faut absolument que je me calme. Que je sorte de ma tête son corps fin et élancé, ses boucles blondes, ses lèvres roses et pulpeuses, ses grands yeux bleus aux cils épais qui lui donnent un air à la fois innocent et buté. Ses formes si parfaitement placées, ses épaules fines, ses pecs dessinés, ses fesses charnues, son regard d’ange. Je bande encore. J’ai toujours été comme ça. Même dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, les plus tendus, je ne peux pas m’empêcher de penser au sexe. De mettre ma queue quelque part au chaud. Dans un bon fourreau étroit, moite, accueillant. De prendre. Juste ça. Prendre. Pénétrer. Posséder. Dominer. Missionnaire, levrette, assis debout. J’ai baisé des filles, j’ai baisé des mecs ; j’ai baisé des cis, j’ai baisé des trans. Au fin fond des soirées les plus glauques, après les cuites les plus dures, avant les échéances les plus cruciales et devant les inconnus les plus lointains, j’ai toujours fini par baiser quelqu’un. Ce n’était jamais vraiment un problème jusque-là, ça faisait juste partie de ma vie ; ça choquait bien quelques personnes – quand j’avais sauté un employé des pompes funèbres à l’enterrement du Grand-Père, ça n’avait pas beaucoup plu – mais dans l’ensemble on me pardonnait facilement. On pardonne toujours plus à ceux qui ont du charisme. Et j’en ai. Je le sais. Je suis grand, musculeux ; ma voix profonde en impose, mon regard perce, mon sourire rassure. Je suis populaire. Je suis sportif. Je fais mâle, je transpire mon surplus de testostérone, je drague sans vergogne et je parle ouvertement de ma grosse bite, sans gêne, avec l’assurance de ceux qui savent qu’ils plaisent et qu’ils peuvent tout se permettre. J’impressionne la plupart des gens. Les autres, ceux qui me détestent, sont juste des jaloux. Évidemment. Maxence, à l’inverse, a toujours l’air d’un gamin égaré. Je l’aperçois derrière les arbres aux troncs tordus, aux branches sans feuilles, là-bas, essayant de se sécher avec la chemise élimée qu’on a trouvée ce matin dans une maison vide. Il semble perdu. Désemparé. Il était comme ça au collège, il était comme ça au lycée : maladroit, désarmé, fragile. Mon souffre-douleur, bien entendu. Je le poussais dans les couloirs, le moquais dans la cour ; je lui lançais très fort, à la cantine, des « alors le pédé, tu suces toujours des bites ? » pour faire rire les potes. Je lançais des rumeurs sur sa vie, l’enfermais dans les toilettes avant les cours, le faisais tomber en EPS. Lui donnais des claques sur les fesses en entrant en cours, juste pour dire aux autres mecs « les tapettes adorent ça » et le faire rougir devant tout le monde. Juste pour l’humilier. Un vrai connard. Il s’approche de moi, qui suis toujours dans l’eau. La tête presque baissée, il dit : Il se détourne aussitôt. Tant mieux, je vais pouvoir sortir sans lui montrer mon érection. Depuis trois jours, il n’y a plus que lui et moi ici. Ici et ailleurs, semble-t-il. ********* Un bruit de verre qui se brise, un petit cri de stupeur. Il vient de faire tomber trois pots de confiture de l’étagère. Des éclaboussures de framboise s’étalent sur ses pieds nus. Je m’approche pour l’aider à attraper les quelques boites de conserves qu’il essayait d’atteindre. Ce n’est pas grand-chose mais ça nous fera tenir deux ou trois jours. J’ai aussi trouvé, près de la caisse, des magazines. Il faut bien s’occuper. Il n’y a plus de réseau, plus d’Internet, plus de communication depuis l’Événement. C’est un miracle qu’on ait trouvé cette épicerie abandonnée. Il n’y a plus beaucoup de nourriture consommable – la chaleur et l’humidité ont déjà tué tout ce qui n’était pas en conserve – mais les murs sont debout et même une partie du toit ne s’est pas effondrée. On pourra y passer la nuit. Par chance, il n’y a même pas de cadavre visible. On s’installe dans un coin. J’ouvre une boite, c’est du canard confit. La sienne, des haricots. On mange chacun en silence. Je le vois porter la main à son pied gauche, encore rouge de la confiture tombée par terre. Il grimace. Il ne s’arrête plus. C’est comme un torrent souterrain qui a trouvé une faille dans la roche et jaillit, se déverse dans la nature, sans limite, sans barrage, rien pour le stopper. Son débit est maintenant tellement rapide que je ne comprends plus ses paroles. Je ne peux pas me mettre à l’abri. Tout est là, tout est dit, sa peine, sa souffrance, son ressentiment, sa haine. Les larmes coulent sur ses joues. Il essaie de reprendre son souffle. Il hoquète. Un mot se coince dans sa gorge. Il ne peut plus parler. De rage, d’impuissance, il serre le poing droit et me donne un coup sur le torse. Juste au niveau du cœur. Je vacille légèrement. C’est toute sa douleur qu’il a mise dans l’attaque. Je m’approche doucement. Je prends sa tête, si fine, si fragile, dans mes mains. Le contraste est frappant et m’excite. Ma peau presque brune contre ses joues si pâles, les poils sur mes avant-bras contre son menton imberbe, mes doigts de géant qui font presque la taille de son visage. Un instant, je pense l’attirer à moi et enfouir ses lèvres contre mon short, lui faire sentir la dureté de mon sexe, plonger violemment mon gland dans le fond de sa gorge. Non. Je lui caresse les cheveux et l’attire doucement à moi. Un bras autour de son cou, ma bouche dans ses boucles blondes, je sens ses sanglots l’agiter contre ma poitrine et ses larmes mouiller mon t-shirt. Je ne dis rien. Nous restons ainsi plusieurs minutes. Lentement, je le sens se calmer. Sans rien dire, avec précaution, je me détache de son corps et descends vers ses pieds. Je prends le gauche en main et, avec toute la délicatesse du monde, je le caresse pour retrouver le morceau de verre. Il est là, sous mon doigt ; je l’ai à peine effleuré qu’il se détache et tombe au sol. La coupure n’a pas l’air trop profonde. À peine une entaille, cachée là sous les coulis de confiture qui recouvrent encore sa peau. Son pied tremble dans ma paume ; j’approche mes lèvres pour y déposer un tout petit baiser, si léger qu’il aurait pu ne presque pas exister ; je le sens frémir. Je ne peux plus détacher mon visage de son pied et je l’embrasse encore. Le goût de confiture sur ma langue. Je lèche une trace de framboise écrasée. Puis une autre. Je le sens se raidir. De ma main gauche, j’appuie sur son torse pour qu’il s’adosse au mur. Je l’y maintiens là, sa cheville dans ma main droite, et je passe ma langue sur chaque partie de sa peau recouverte de liquide fruité. Je m’y attarde de longues minutes. J’entends sa respiration ralentir. Il gémit doucement. J’embrasse son pied encore et encore, avec tendresse, passion, dévotion. Ma langue s’attarde dans chaque repli, chaque recoin, chaque blessure cachée. Je vais le guérir. Dans mon short, ma bite est plus tendue que jamais. ********* Nous marchons presque sans interruption depuis neuf heures déjà. Il est quelques mètres devant moi. J’observe son cul se balancer à chacun de ses pas. Je voudrais y enfouir mon visage, l’écarter à pleines mains pour y fourrer ma langue, le faire gémir jusqu’à ce qu’il me supplie de le pénétrer brutalement. Je me suis branlé hier soir en l’imaginant à quatre pattes, fesses ouvertes, ma queue raide plantée profondément en lui et déversant des litres de sperme dans ses entrailles. Nous avons beaucoup parlé depuis la nuit dans l’épicerie. Je lui ai dit et redit à quel point j’étais désolé pour tout le mal que je lui ai fait pendant toutes ces années. Il se méfie encore. Je vais devoir gagner sa confiance. Il se retourne vers moi : Après quelques minutes, nous atteignons une caverne, en effet suffisamment large pour y dormir. Je sors de mon sac la couverture arrachée ce matin au corps sans vie d’un homme trouvé par hasard près du chemin. Il fait tout son possible pour limiter les contacts entre son corps et le mien. Je le sens tendu, allongé sur le dos. La couverture ne nous recouvre plus tout à fait. Je m’approche de son oreille : Je me réveille alors que le soleil n’est pas encore levé. Lui dort encore. J’ai besoin de pisser. Je m’extrais délicatement de la couverture pour m’éloigner de quelques mètres. Arrivé au niveau du ruisseau, debout, la bite dans la main droite, je me soulage à longs jets dans l’eau qui s’échappe bruyamment, en contemplant ma queue. Même au repos, elle est bien large et veineuse. Je suis très fier de ma bite. Elle est bien proportionnée, d’une bonne longueur mais surtout très large ; j’en ai fait crier des salopes. Je me caresse un peu les couilles, sans rasoir disponible depuis l’Événement les poils ont bien poussé. Elles sont lourdes, pleines de sperme. Je jute toujours beaucoup. J’adore recouvrir de jus la gueule des filles et des mecs. Ou leur remplir le cul. Pas la chatte, je ne veux pas prendre de risque. Je retourne dans la grotte et l’observe. Il dort profondément, toujours sur le côté, ses beaux yeux fermés montrent ses paupières hautes, sa bouche légèrement entrouverte laisse entrer et sortir l’air. Je ne peux plus résister. Je m’approche un peu plus, m’agenouille près de lui, me caresse. Je bande vite. Ma queue est lourde et chaude dans ma paume. Je me masturbe, très vite. Je veux jouir. Je veux me faire sortir tout le jus, vite, avant qu’il se réveille. Mon gland humide est presque sur ses lèvres. Je l’imagine se réveiller, me voir, ouvrir grand la bouche de stupeur et moi gicler sur sa langue avant qu’il ne puisse faire un geste, puis le forcer à tout avaler. Je vais cracher. Je dirige ma bite vers le haut de sa tête, ça monte, ça vient, cette chaleur qui voyage de mes cuisses à mon ventre, qui remonte dans mon sexe tendu ; c’est là, putain ! Je jouis, je gicle, mon sperme jaillit brutalement en longues giclées épaisses et blanches. Une première se mêle à ses cheveux blonds, je dirige les autres vers le sol. Ça continue. Trois jets, puis quatre, puis cinq. Je redescends. Putain que ça fait du bien. Je suis vidé. Mes couilles se resserrent. Je me sens un peu con. J’ai pris des risques. Il aurait pu se réveiller. Pourvu qu’il ne remarque pas le liquide visqueux sur ses cheveux. ********* Septième jour. Le froid s’est installé, durablement semble-t-il. Un changement brutal après la moiteur qui nous avait suffoqués dès la fin de l’Événement. Le soleil, incertain, ne se lève plus jamais vraiment, ou alors les nuages étouffent sa lumière. Nous avons raccourci nos journées de marche. Nos shorts ne nous permettent pas de supporter trop longtemps les températures hivernales. Les changements brutaux dans la météo, ajoutés à l’incertitude du lendemain – si lendemain il y a – jouent sur notre moral. Maxence pleure, souvent. Il se cache. Je l’entends. Nous dormons à présent chaque nuit, serrés l’un contre l’autre, sous la même maigre couverture. Je ne m’inquiète plus de masquer mes érections. Elles sont là, dures, constantes, incontrôlables ; présentes dès l’instant où son corps se serre contre le mien. Il ne peut pas l’ignorer. Nous n’en parlons pas. Ce soir d’étranges insectes – ou peut-être des oiseaux, des mammifères, des branches – chantent un air mystérieux qui nous tient tous les deux éveillés. La respiration lente, les yeux grands ouverts, la queue raide, je fais sembler de ne pas m’inquiéter tandis que mes bras s’enroulent fermement autour de sa taille. Lui serre mes poings dans ses doigts menus que je voudrais tant porter à ma bouche. J’ai hurlé. J’ai lancé ça comme un appel. C’en était un, je crois. Un cri. Venu du plus profond de moi. Il a les yeux grands ouverts, fixés sur moi. Moi aussi, il me semble. Un long silence s’installe, immobile. Soudain, il sourit : J’écoute. Il a raison. Les crissements du dehors se sont tus. Je me redresse à mon tour et l’attire vers moi, doucement. Il se laisse faire. Je le prends dans mes bras, lentement je l’enserre. Je pose son visage sur mon torse. Il passe un bras autour de mon ventre. Je caresse ses cheveux. Dans la fraicheur du soir, sous l’ombre des tempêtes, le silence est à nous. Je crois qu’il me comprend. Je sais qu’il peut m’entendre. Après de longues secondes, je commence à parler. Lui dire ces années à l’observer, l’envier, le vouloir, le chérir. Ces pulsions refrénées. Ces pensées complexes, torturées. Sombres. Lui avouer que je n’ai même pas de remord, que je repense encore à ses joues rougissantes sous les insultes qui pleuvaient il y a un an, il y a siècle, il y a une éternité ; et qu’y penser me fait bander. Que je ne sais pas expliquer, que je ne sais pas dire pardon, parce que malgré moi, malgré sa douleur aujourd’hui en plein jour, il y a encore, ce soir, en cet instant, une part de moi qui s’y reconnaît. Qui aime son mal. Qui se nourrit de sa souffrance, qui se grandit de la provoquer, qui s’excite de son pouvoir et qui ne peut pas se passer tout à fait de ce sentiment d’être supérieur, dominant, tout-puissant. Lui murmurer que je n’ai pas su m’exprimer autrement et qu’encore à ce jour je ne sais pas faire mieux. Lui confier mes libertés nouvelles, mes expériences récentes. Mes aventures, mes conquêtes, mes pulsions. Il écoute. Sans sanglots, sans frémir, il entend. Ma main sur son visage sent ses larmes couler. Il se libère lentement de ses années de doute, d’errance ; il boit mes paroles comme un antidote aux violences, aux trop nombreux coups que je lui ai portés. Le drame s’achève, doucement. Avec ses mots précis, choisis, il me dit ses angoisses et ses peines. Il épand ses confidences les plus noires, avec la confiance désespérée de ceux qui n’ont plus rien à perdre. Il confie ses fantasmes, ses nuits passées à penser à moi, à tous ceux qui lui faisaient du mal, à tout ce qui cherchait à l’achever et dont il se saisissait, en rêve, pour en faire des récits érotiques dont il avait enfin la maîtrise. Il me raconte ses longues soirées à nous imaginer lui et moi, amants tragiques, désespérés, violents ; lui prisonnier consentant de mes violences sexuelles, quémandant mes insultes, souriant à mes crachats ; moi le forçant à se soumettre à mes fantasmes les plus extrêmes, exprimant mon plaisir de le voir avili, jouissant sans cesse de ses soupirs esseulés. Il me dit aussi ses rencontres, réelles, au hasard, avant l’Événement, avec des inconnus qu’il fantasmait en bourreaux. Il dit sa soumission, ses passions, ses obéissances aux demandes les plus humiliantes d’anonymes auxquels il prêtait mon visage, mon corps, ma voix, ma corpulence, mon nom. Il dit, et je comprends, son sentiment à lui d’être dans la commande quand il semble obéir ; il exprime, et j’entends, cette impression qu’il a d’être enfin à sa place, en contrôle, sous les coups, les insultes ; qu’il est comme un cours d’eau au débit si puissant que les mâles qui s’y baignent croient lui faire barrage ; mais ils lui échappent, toujours, s’échouant plus loin, tandis qui lui s’enfuit sous les ordres impurs d’hommes nouveaux qu’il oublie chaque fois sur de nouveaux rivages. Plus encore qu’avant nos confidences, je bande à en mourir. Ses mots, ses soupirs, sa respiration courte, la peau de son visage, enflammée, contre les muscles de ma poitrine, ses bras légers autour de mes hanches, le contact de son dos que je caresse d’une main, l’odeur de ses cheveux dans lesquels j’ai enfoui ma tête, se mêlent aux images défilant dans mon esprit au rythme de ses confidences déchainées. Je le vois soumis aux désirs pervers de ces mâles qu’il raconte et, plus que jamais, je veux le soumettre aux miens. Je saisis ses cheveux, redresse son visage vers moi et force son regard à plonger dans le mien. Je le vois, les larmes aux yeux, de son air suppliant qui pourrait me prier pareillement de le relâcher ou de ne jamais le laisser partir. Les yeux toujours plantés dans les siens, de la main droite je baisse mon caleçon déchiré pour libérer ma queue tendue à l’extrême ; puis de la main gauche je plonge brutalement son visage vers mes cuisses. Je n’ai rien à dire qu’il a déjà ouvert les lèvres pour me laisser violemment pénétrer sa bouche. D’un coup j’enfonce mon sexe raide tout au fond de sa gorge et le sens aussitôt resserrer les lèvres sur la base de ma bite. Ma main toujours dans ses cheveux, le poing fermement refermé sur ses boucles blondes, je lui impose alors des va-et-vient bestiaux, fais entrer et sortir de sa bouche délicate tout la longueur de ma queue, force de mon gland le fond de sa gorge assoiffée, glisse ma bite sur ses lèvres roses et sa langue humide, le maintiens par instants la tête entière enfoncée sur ma verge gonflée d’excitation ; quand je sens son corps tressaillir et chercher l’oxygène je le repousse durement pour le laisser, une très courte seconde, inspirer, avant de le replonger d’autorité vers la toison drue de mon pubis. L’entendant essoufflé après plusieurs minutes de ce traitement, je le rejette violemment en arrière et l’allonge sur le dos. Avec rudesse je m’assois sur son torse frêle, les jambes de part et d’autre de son corps ; d’une main je lui saisis le cou, de l’autre j’ouvre sa bouche. Je plonge un instant mon regard dans le sien et y lis l’entièreté de sa soumission. Je grogne. Je ne me reconnais presque pas tout en étant plus moi-même que jamais auparavant. Il est là, sous mon poids, tout à moi, victime consentante du déchaînement de ma violence et de mes pulsions, pantin dépendant de ma tyrannie, tout entier attentif à mes tourments ; ses yeux grands ouverts, son regard bleu planté dans le mien, me disent à la fois son accord et sa retraite. Il m’appartient. Je le laisse un moment prendre la mesure de la situation puis, avant qu’il se puisse penser s’y dérober, lui crache au visage, une fois, deux fois, trois fois. Il a fermé les yeux, par réflexe, par surprise. Je regarde ma salive couler sur sa peau, souiller la pureté de ses traits, marquer sans retour mon territoire conquis. Nous savons lui et moi que cet instant est sans retour. Il s’est offert à moi avec l’humilité vaincue de ceux qui ont perdu la guerre sans avoir combattu. Ses lèvres humides sont encore entrouvertes. Ma bite, raide, rouge, large, engluée de pré-cum, le surplombe. Avec toute la brutalité de ma domination mâle, je m’engouffre dans sa bouche. Il ne m’y faut plus que quelques mouvements, couplés à la sensation chaude du fond de sa gorge se refermant sur mon gland, pour jouir en longs râles rauques. Je me déverse dans sa bouche, son palais, sur sa langue, ses amygdales et son larynx, libérant tout mon sperme, en jets bouillants, violents, incontrôlables. Je sens mes couilles se vider de leur jus pour en remplir sa gorge. Mes mains fermement refermées sur son cou, je lui maintiens la tête enfoncée sur ma bite, jouissant encore de ses hoquets soumis, des bruits humides de mon sperme descendant lentement dans son estomac. Sous mes doigts, les mouvements délicats de sa gorge impuissante, déglutissant mon jus, m’excitent encore. Les yeux levés au ciel, le corps toujours tendu, les mains crispées sur sa peau fine, je profite plusieurs minutes de cet instant suspendu. Ma queue dans sa bouche perd lentement de sa vigueur. Ma jouissance n’en finit pas. Je me sens maître, seigneur, puissant. J’entends un léger râle, comme un soupir, presque une plainte. Mon regard se porte à lui. Il est là, allongé sur le dos, coincé entre mes cuisses ; ses cheveux en bataille, couverts de bave et de sueur, forment un halo doré autour de son visage stupéfait. Il a ouvert les yeux et son regard me dit tout l’amour qu’il me porte. Ou bien l’adoration. Je ne sais pas. Je m’en fous. Je ne pense qu’à sa bouche, rose, sensuelle, ouverte, abandonnée, soumise. ********* Onzième jour. La journée commence, comme chaque matin maintenant, par ma queue dans sa gorge. Allongé sur notre couverture, je baisse les yeux vers sa tête enfouie entre mes cuisses. Sa main droite enroulée autour de la base de mon sexe, la gauche me caresse les couilles tandis que sa langue joue avec mon gland. Je la sens passer et repasser sur le frein, s’attarder sur le méat, descendre vers le pubis pour laisser toute ma longueur lentement pénétrer le plus profond de sa bouche. Il est doué. Très doué. Ce n’est pas juste son expérience – et je sais qu’il en a – c’est sa volonté surtout. Il cherche à satisfaire. Il veut faire plaisir. Il donne de tout son être pour contenter son partenaire. Je lui prends les cheveux, le force à me regarder. Son visage est luisant de salive. Sur son front humide, ses boucles blondes se sont collées à sa peau. Sa bouche entrouverte, aux lèvres épaisses, dévoile ses dents blanches. Ses yeux bleus grand ouverts me supplient de lui rendre ma queue. Un léger râle lui échappe. Mes vingt centimètres se posent sur sa joue ; il ouvre encore la bouche et me lèche le gland ; la pression de ma main sur sa tête se relâche et il descend jusqu’à mes couilles pour passer sa langue tout le long de ma queue avant de toute la prendre d’un coup entre ses lèvres et de me faire un fond-de-gorge. Je me tends, je vais gicler, il m’attrape les couilles, remonte, redescend ; je sens le jus monter en moi, je grogne, ça vient, je vais cracher, il le sait et prend toute ma queue dans sa petite bouche docile pour avaler comme le bon soumis qu’il est. Il garde ma bite dans sa bouche jusqu’au bout, jusqu’à avoir tout tiré et que mon sperme chaud ait rempli son ventre. Amoureusement, sa langue me lèche encore. Je l’attire alors vers moi et cale sa tête contre mon torse. Nous restons là, enlacés, de longues minutes. Je caresse ses cheveux tandis que ses doigts courent sur mon ventre et jouent avec les poils sur ma poitrine. Je crois que je l’aime. Déjà. Je le lui ai dit. Est-ce la solitude ? La peur d’un lendemain qui peut-être ne verra jamais le jour ? Est-ce purement sexuel, ou bien la perversion de mon esprit satisfait de l’avoir à moi, obéissant, prisonnier des circonstances, résigné à son sort, sans fuite possible ? Ça n’a pas d’importance aujourd’hui. Depuis dix jours, nous avons appris, forcés, à ne compter que sur le moment présent. Il a accepté mon amour avec la prudence que ses années de torture lui ont enseignée. Il m’a dit, simplement, qu’il lui fallait encore apprendre à me faire confiance. Qu’il était heureux de m’avoir avec lui, qu’il se sentait en sécurité, protégé, aimé mais qu’une part de lui craignait encore qu’il s’agisse d’un jeu, d’un piège, d’un tourment nouveau fait pour le blesser. Il se réveille, parfois, avec la brève certitude que je suis parti ; et quand le contact de mes bras autour de son corps, de ma queue tendue contre ses fesses, l’assurent soudain de ma présence, m’offrir sa bouche et sa gorge sont pour lui comme un merci. Et quand, le soir, il descend à nouveau entre mes cuisses pour s’occuper de moi et me vider encore, c’est sa façon de me convaincre de ne pas partir pendant la nuit. Il s’endort en priant que je reste. Il se réveille reconnaissant que je sois toujours là. Merci de ne pas m’avoir abandonné. En l’entendant formuler ces mots, mon cœur s’est serré. J’ai voulu, plusieurs fois, m'attaquer à son cul. Il n’est pas prêt. Pas encore. Ça aussi il l’a dit, simplement, honnêtement, en douceur. Il a besoin de me faire confiance. Je me suis étonné sur le coup : il s’est donné à tant d’autres, tant d’hommes, tant d’inconnus rencontrés n’importe où ; pourquoi ces difficultés avec moi ? Mais je comprends. Je l’ai tant blessé. Il m’a tellement haï. J’ai pensé plusieurs fois le forcer. Je pourrais, facilement. Il est si frêle, si menu ; et s’il crie, qui viendra à son secours ? Il n’y aura personne. Je me retiens. Un jour, bientôt, il dira oui, et je le prendrai enfin, avec toute la violence de ma frustration. Je plongerai ma bite d’un seul geste dans son trou, sans attendre, brusquement ; je le ferai crier de douleur et de joie, je le pilonnerai brutalement sans lui laisser le temps de s’y faire. Je lui ferai du mal, je me ferai du bien. Et je jouirai d’autant plus qu’il aura accepté ma violence, ma brutalité, qu’il m’aura laissé le pénétrer en sachant par avance que j’allais le baiser sans douceur ni pitié. Il m’en aimera d’autant plus. Un jour. Bientôt. Je m’excite souvent à lui faire raconter ses rencontres d’avant l’Événement. Je sais les lieux qu’il a fréquentés. Les aires d’autoroute où il allait s’offrir à qui voulait. Les nuits qu’il a passées à se faire baiser par des dizaines d’inconnus. Les coups qu’il a volontairement reçus, qu’il a demandés, les gifles qui l’ont fait jouir. Les fantasmes qu’il a réalisés, toujours dans la soumission, parfois dans le danger. Il me raconte ce traumatisme qu’il a vécu, il y a plusieurs années, quand un homme qu’il avait rencontré l’a forcé à rester chez lui, attaché plusieurs jours. Il avait craint pour sa vie. Il me dit que depuis il a une aversion, profonde, pour les corps trop maigres de ceux qui lui rappellent ce type-là. Qu’il s’est souvent facilement laissé posséder par n’importe qui, sauf les hommes grands et maigres. Je le rassure en promettant de ne jamais maigrir. Ça le fait rire. Je lui ai proposé de le faire jouir lui aussi. Je lui ai dit que je pouvais le masturber. Le caresser. Le sucer un peu, même – je ne suce presque jamais mais pour lui, je suis prêt. Il m’a demandé de simplement l’embrasser pendant qu’il se branlait. Ça a été magique. Ses lèvres sur les miennes, sa langue enroulée sur ma langue, ses gémissements fébriles, nos salives mélangées ; sa main droite s’activait sur son sexe, sa main gauche s’agrippait à mon cou ; je caressais ses cheveux, son torse, ses couilles, ses cuisses ; je sentais ces palpitations légères agiter tout son corps allongé sous le mien. Mon genou calé contre son trou, j’avais joui dans sa bouche quelques minutes auparavant mais je sentais déjà l’excitation remonter en moi. Il ne lui avait fallu que quelques courts instants pour éjaculer, dans un soupir profond, sur son ventre. Son sperme avait jailli en longs jets blancs dont le premier avait atteint son téton gauche. De légers spasmes l’agitaient encore quand j’avais recueilli son jus dans mes doigts pour le porter à ses lèvres. Les yeux toujours fermés, il les avait léchés un par un. Tendre. Offert. Soumis. Son sperme luisait sur ses lèvres roses. Quand il avait enfin ouvert les yeux, son regard me disait qu’il m’aimait. Je crois. J’espère. Je sais qu’il lui faudra pouvoir le dire avant de me laisser le prendre. ********* Treizième jour. Le froid s’est définitivement installé. Comment sommes-nous passés de cette accablante chaleur humide à ce vent sec et mordant, de cette fournaise tropicale à cet hiver polaire, en une courte semaine ? L’Événement semble avoir changé la face du monde, pour le pire. Nous n’avons pas trouvé d’abri ces derniers jours. Nous sommes inquiets. Nous marchons toujours, mais sans but. Nous avions espéré rencontrer d’autres survivants, peut-être une ville épargnée quelque part, de la nourriture consommable. Mais partout ce n’est que mort, destruction. Là où se tenaient des commerces, des bureaux, des immeubles, il n’y a plus que cendre et gravats. La faim nous tenaille. Nous n’avons plus rien à manger, à part les quelques feuilles mortes et morceaux d’écorce d’arbres que nous trouvons ici et là. Nous nous arrêtons souvent, épuisés, affamés. Nous avons pensé faire demi-tour pour retrouver les quelques maisons à moitié debout que nous avions croisées lors des premiers jours, mais nous avons à présent trop avancé pour retourner sur nos pas. Il faut garder espoir. Continuer. La nuit menace de tomber quand soudain, devant nous, comme un mirage, un mur de béton. Je passe un bras devant Maxence pour l’empêcher d’aller plus loin. Je veux d’abord m’assurer de sa sécurité. Ne pas lui faire prendre de risque. Il s’agenouille là, dans les feuilles mortes. Je m’avance vers la structure. On dirait un bunker. Probablement là depuis la Guerre, couvert de tags, mais solide encore. Où sommes-nous ? Nous n’avons pas vu la mer depuis notre départ ; peut-être avons-nous marché vers l’Est ? Le soleil, imprévisible depuis l’Événement, ne nous a pas permis de reconnaître nos directions. J’aperçois l’ouverture, sur le côté, et entre. La structure est étonnamment vaste. Une pièce d’au moins neuf mètres carrés, puis un mur intérieur, sa porte défoncée et derrière, semble-t-il, un renfoncement. Il fait trop sombre pour distinguer ce qui s’y trouve. Je ressors pour faire signe à Maxence de me rejoindre. Nous camperons là cette nuit. Demain matin, quand il fera jour, nous chercherons de la nourriture. J’installe notre couverture au sol, dans un coin, et nous nous asseyons. Toujours dans la même position, moi adossé au mur, jambes écartées, lui dos à moi, sa tête dans mon cou, assis entre mes cuisses. Un bras autour de son torse, j’embrasse ses cheveux dorés tandis que sa main vient se glisser vers mon visage pour caresser ma joue. Mes doigts glissent sous son t-shirt, viennent appuyer sur ses tétons imberbes, sensibles, l’un après l’autre ; je les prends, les caresse, les malaxe, je lui fais presque mal tandis que ses gémissements me disent son plaisir. Je bande. Il glisse une main entre son corps et le mien pour venir agripper ma queue raide, mon gland déjà humide. Je lèche son cou. Sa tête part sur le côté, je lève un bras pour libérer mon aisselle. Il respire à grands coups mes odeurs de mâle. Je voudrais l’étouffer sous l’air humide de ma transpiration. Lui faire lécher mes poils. Le gaver de ma testostérone. Je le déshabille, lentement. Il bande lui aussi. Sa bite raide, sous son pubis blond, laisse perler quelques gouttes de pré-cum. J’attrape son sexe de ma main, le masturbe un instant puis porte mes doigts à ses lèvres pour lui faire lécher sa mouille. Nous n’avons pas changé de position. Assis, lui entre mes cuisses, son dos contre mon torse, je le surplombe. J’ai une vue plongeante sur son ventre plat qui se soulève à chacune de ses respirations excitées. Ma main droite plonge à nouveau vers son sexe tendu pour couvrir encore mon index de sa mouille. D’instinct, il écarte les cuisses. Mes doigts glissent cette fois sous ses couilles et y déposent son liquide pré-séminal. Je recommence, encore. Encore. Il mouille beaucoup ce soir. Moi aussi. Je suis toujours habillé mais il a libéré ma bite de mon short ; elle est plaquée contre le haut de son cul. Je sens mon pré-cum inonder ses fesses. Je le caresse encore sous les couilles ; mes doigts trouvent vite le chemin de son trou. Attentif à sa réaction, je m’assure qu’il me laisse faire. Il ne dit rien, la tête renversée en arrière, sur mon torse, les yeux fermés il gémit doucement. Je passe un premier doigt entre ses fesses, le bras plaqué contre son torse je le maintiens collé à moi, enveloppé, coincé, protégé, prisonnier entre mon ventre et mon biceps. Son trou est là, sous mes doigts, chaud, humide, palpitant. Il s’offre à moi. Enfin. Une vague d’émotion me submerge. Sa confiance, enfin, répond à mon amour. Je l’aime. Putain, je l’aime. Dans les tourments de ces deux dernières semaines, dans l’enfer traversé, dans l’inconnu d’un futur incertain et d’une mort probable, nous nous sommes trouvés. Il n’y a besoin d’aucun mot, d’aucune parole, même pas d’un regard : son corps tout entier offert à mes attentes et mes envies me dit qu’il est à moi, que je suis à lui, que nous nous aimons. Vraiment. Profondément. Sans peur, sans crainte du rejet, de la trahison. Les années de torture sont oubliées, balayées, envolées, appartiennent au passé. Il me fait confiance. Je peux le prendre, le posséder, il a baissé toutes ces gardes et se donne à moi, entièrement. Ce soir je ne lui ferai pas mal. Je lui ferai l’amour. Je le prendrai comme je n’ai jamais pris personne, avec tendresse, avec amour, avec passion. Je serai attentif à son plaisir, je lui donnerai tout le bien-être qu’il mérite, c’est sa satisfaction qui sera reine, avant la mienne, avant toute autre chose. J’ouvre la bouche pour lui dire que je l’aime. - Ne bougez pas. C’est un fusil devant nous. Son canon luit dans la pénombre. Il est pointé vers nous. Nous restons immobiles. Je sens contre ma peau le corps de Maxence agité de brusques respirations rapides. Putain. Qui est là. Qu’est-ce que c’est. Qu’est-ce qui se passe. Nous n’avons croisé aucun autre être vivant depuis près de deux semaines. Et là, soudain, quelqu’un. Armé. Qui nous menace. Maxence essaie de se relever. Il est toujours nu. Je le maintiens en place. Malgré la peur, je parviens à prononcer : Son fusil est toujours pointé vers nous. Maxence est le plus rapide. Il attrape son t-shirt, son short et se redresse. Je suis toujours habillé. Sous le regard de l’inconnu, nous sortons du bunker. Il n’a pas baissé son arme et nous maintient en joue. Nous n’osons pas parler. Il me regarde et reprend : Je n’ose pas regarder Maxence. Mon regard reste fixé sur l’inconnu au fusil. Je le détaille. Son corps haut, maigre, sa mine hirsute. Il n’est pas laid. Du moins, il n’a pas dû l’être toujours. On distingue sous sa barbe sale une mâchoire dessinée. Ses yeux sont petits, creusés, mais ont pu être beaux avant l’Événement. Sur son épaule et son avant-bras, des traces de brulures récentes sur la peau, qui laisse apercevoir les contours de ses os saillants. Mais avant ? Il n’était sans doute pas si maigre. Si inquiétant. Je me secoue mentalement. Je sais ce que je fais. Je cherche à me convaincre qu’il ne ressemble pas à celui dont Maxence a parlé. L’homme qui l’avait séquestré. Qui lui avait fait craindre pour sa vie. Qui lui a donné cette aversion pérenne pour les corps décharnés. Je sens le regard de Maxence sur moi. Je sais qu’il me regarde. Je sais qu’il me dit non. Je ne peux pas lui faire ça. Pas maintenant. Pas ce soir. Jamais. Il vient de me donner sa confiance. Son amour. Il y a dix minutes encore, tout son corps m’exprimait qu’il était à moi. Qu’il croyait en moi. Je ne peux pas le trahir. Pour des boîtes de conserves. Trois jours de nourriture. Dans le silence, soudain, mon estomac gargouille. Bruyamment. L’inconnu sourit. Un sourire froid, méchant. J’ai cédé. Avant même de le savoir, j’ai cédé. Mon ventre a parlé pour mon cerveau. Pour mon cœur. Il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Les bruits incontrôlés de mon corps avide de nourriture ont tout dit de mon accord. Je sais tout ce que j’abandonne, ce que je sacrifie. Treize journées et treize nuits à tisser ce lien, ténu, fragile, à créer la confiance ; treize journées et treize nuits à lui dire, par mes gestes, par mes mots, par ma simple présence, qu’il pouvait me croire. Que je ne lui ferais pas de mal. Qu’il était en sécurité. Et ce soir. Un appel. Mon ventre qui lui dit, d’un serrement d’entrailles affamées, qu’il est vendu pour trois boîtes de conserve. Il est trop tard. Même si je disais soudain non, je refuse, je ne veux plus, la trahison est là. Je ne peux pas la défaire. Ma tête ne fonctionne plus. La faim dicte mes gestes. La faim a pris contrôle. C’est la faim qui commande à mon corps tout entier. C’est la faim qui me fait baisser les yeux. C’est la faim qui demande à mon bras de pousser Maxence vers l’avant. Vers l’homme. Vers l’inconnu. Je sais, je sens, son regard lourd toujours sur moi. Sa haine brutalement réveillée. Il s’avance. Sans lever la tête, dans ma lâcheté honteuse je perçois la bête hirsute reculer pour rentrer dans le bunker. Lent, digne, droit, condamné, comme il irait au bûcher, Maxence le suit. Ils disparaissent l’un puis l’autre dans l’obscurité froide du béton tagué. ********* J’ai passé la nuit, là, assis dans les feuilles mortes, recroquevillé sur moi-même, les bras serrés autour de mes genoux, les joues trempées, à écouter Maxence se faire baiser par l’inconnu. J’ai deviné les séquences, sa bouche occupée, pleine du sexe raide de l’homme, dont les doigts sales et maigres prenaient possession de son cul. J’ai perçu le moment où il l’a pénétré, brusquement, sans douceur, sans amour. J’ai entendu les cris douloureux de celui à qui, il y a quelques minutes encore, je murmurais je t’aime. J’ai su qu’il était en train de se faire prendre, à quatre pattes, cambré de force par des mains indignes, et qu’il pensait à moi dans sa douleur. Qu’il me maudissait. Les grognements bestiaux de l’homme à la barbe m’ont dit le moment précis où il a inondé de son sperme le ventre de mon amant. De mon amour. Je savais sa souffrance. Je savais sa douleur. Je savais que c’est moi qui aurais dû être en lui, au plus profond de lui, enfoncé dans son intimité. Je l’aurais fait crier aussi. Mais de plaisir et de bonheur. J’ai bandé à nouveau. Je me suis détesté. Au petit matin, Maxence est sorti du bunker. Il portait deux sacs à dos. Pleins. Je me suis relevé. Je l’ai regardé. Suppliant. Ses yeux rougis, cernés, étaient froid. Il ne s’est pas approché. Moi non plus. D’un geste, il a lancé l’un des sacs à mes pieds. Il est resté là, immobile, dans ce qui m’a semblé durer un siècle, sans prononcer un mot. Il n’avait rien besoin de dire. Je savais tout ce qu’il exprimait. Il ne me haïssait même pas. Il n’était pas déçu. Il n’était pas surpris. Il avait retrouvé en moi, la nuit dernière, le bourreau odieux qui l’avait toujours torturé, et qui n’était jamais parti. Il avait eu raison. Le corps droit, rigide, majestueux, il était à la fois blessé et à la fois puissant. Délivré. Il s’est retourné. Un ruisseau calme et plat passait sur le côté. Sans jeter un regard en arrière, son sac à dos sur les épaules, il l’a traversé et a disparu dans les arbres. Je n’ai pas bougé depuis. Je suis toujours là. Prisonnier de mes remords. De ma peine. Devant moi, l’entrée du bunker me hante et m’appelle. Sombre. Froide. Silencieuse. FIN Romain
📊 Cette histoire a reçu 40 votes et 53 lectures.Retour au Hit&Hot Parade |
📚 Autres histoires en lice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour au Hit&Hot Parade |
|